L'anathème

Roman
Judith annonce, en ouverture du roman, la disparition dramatique de son compagnon, Frédéric, dans les déserts du Haut-Atlas marocain. Accident, suicide ou exil volontaire ?
Elle entreprend de mener l’enquête en suivant pas à pas l’itinéraire tracé par Frédéric dans ses lettres et journaux. Tout au long de ces pages, déployées comme des éphémérides, Frédéric relate ses rencontres ambiguës, entre chaos émotionnel et malentendu chronique, avec Pascale, une jeune étudiante. Il y traque aussi l’origine de son malaise. Un anathème ancien pèse sur lui, lancé par une figure maternelle dévorée de fantasmes.
Dans l’investigation de l’histoire familiale, le parcours est semé d’embûches. Une conspiration silencieuse, à l’oeuvre de longue date, est organisée pour détourner les questions sur les bannis de la mémoire. Le récit halluciné côtoie le document d’archives. En voulant rétablir les faits, Frédéric tente de reprendre barre sur sa destinée. Mais la quête est sans fin, elle devient une réponse philosophique.
Judith, rassemble les éléments, les témoignages. Elle veut croire que Frédéric s’est volontairement retiré dans le Haut-Atlas. Est-elle encore lucide ou déjà égarée lorsqu’elle décide éperdument de partir sur ses traces ?
L’Anathème est un roman publié aux Editions La Bartavelle. 1999, 198 pages.
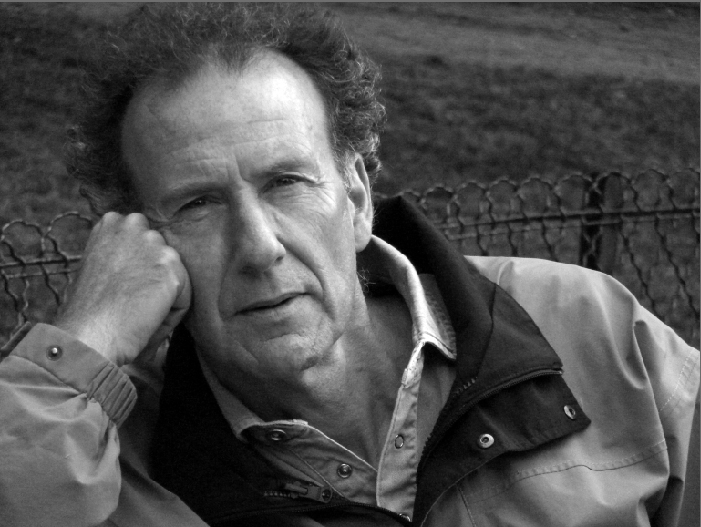
L’Anathème
Extraits des premiers chapitres
Judith
Fontenay-sous-Bois, jeudi 17 août 1995
Au coin de la table de travail de Frédéric, il y a un petit fourre-tout de bois peint, rouge et or, que j’ai acheté à Saint-Petersbourg pour le lui offrir. Il contient des clés dont je ne connais plus l’usage, des trombones, des cartes de visite, une gomme et aussi de minuscules crayons qu’il emportait pour ses promenades. Petit fouillis. Traces de vie. Posé sur une liasse de factures et de courriers en attente de réponse, l’objet sert aussi de presse-papiers. Face à la fenêtre, la vue est dégagée, mais je préfère écouter les bruits. Cri des hirondelles, passage animé d’un groupe d’enfants, grondement sourd du RER, toutes les sept minutes, moins bruyant à cette heure du jour, puisque les rames sont plus courtes. Bruits quotidiens, plutôt rassurants.
Retour à l’appartement, je me suis installée à cette table, après deux semaines chez Danièle. Elle m’a hébergée, lorsque j’ai appris la disparition de Frédéric. Puis je me suis décidée à revenir ici, juste après la cérémonie funèbre. Redoutée, cette rentrée dans l’appartement vide. Mais nécessaire, sans doute. Je poursuis mon journal, une obligation que je me suis faite, un moyen d’affronter l’absence. Autrement, comme avec Danièle ces derniers jours, je me transforme en un pantin gesticulant. Et puis, quelque chose à chercher. Je ne sais encore quoi, au juste. C’est le sentiment, peut-être idiot, d’un secret tapi quelque part dans notre appartement. Une allusion dans sa dernière lettre ? Y aurait-il un motif d’espoir? Des chimères, sans doute, auxquelles je veux me raccrocher !
On se terre dans sa douleur. Comme dans la fièvre au fond d’un lit. Cela conduit au silence. Parler, écrire, si difficile. Il faudrait de l’espoir pour cela. La souffrance, un fond de malaise continu, sur lequel alternent des moments de stupeur et de fulgurantes morsures. Faut-il tenter d’accepter, puisqu’il l’a voulu ? Il pensait sûrement que je parviendrais à dépasser cela. Il plaisantait sur l’énergie qu’il me supposait : forte comme un gorille, répétait-il. Y a-t-il trouvé une excuse, pour se débiner de cette façon ? Quelle lâcheté, vis-à-vis de ceux qui restent : la situation ne me convient plus, j’ai des états d’âme, je suis las de l’existence, ciao la belle, je fais ma valise ! C’est monstrueux !
C’est survenu il y a un peu plus d’un mois, dans le Haut-Atlas marocain. Chute dans un gouffre. Recherches difficiles, plusieurs jours après, par une équipe spécialisée. Pas de corps. Sans doute emporté par la crue de l’oued après les orages. Quelques jours auparavant, il m’avait fait parvenir une lettre, dont le sens était ambigu. Je ne peux y voir, désormais, que l’annonce de sa volonté de se supprimer. Après trois semaines de recherches sans résultats, ses parents ont voulu organiser un service religieux. Celui-ci se déroulait hier, chez eux, à Saumur.
Le service funèbre avait lieu dans la paroisse de ses parents. Petit notable de province à la retraite, catholique rigoriste, le père de Frédéric, posté dans le choeur de l’église, battait la mesure, entonnait les cantiques. Son élan me laissait stupéfaite. Et l’assistance reprenait les chants, avec un souffle croissant. La liturgie suivait une progression étudiée, visant à susciter un crescendo émotionnel.
L’homélie finale fut déclamée par un prêtre sur un ton particulièrement convaincu. Il ne connaissait pas Frédéric. Il est passé d’une pirouette sur sa disparition, sur son dernier courrier, pour parvenir à une étonnante conclusion selon laquelle cette mort était un événement heureux puisque Frédéric en avait terminé avec ses souffrances de la terre. Il fallait se réjouir ! Pas de pleurs, ce serait un manque de foi ! Et, maintenant, il fallait que les vitraux de l’église se mettent à trembler en écho à nos chants d’adieu à notre frère Frédéric ! Sur ce, le cantique final fut repris à plein poumons par les fidèles. On sentait l’exultation du devoir accompli. Le prêtre a pris une dernière fois la parole pour inviter l’assistance à emporter la feuille liturgique de la cérémonie pour que chacun puisse méditer chez soi. Bonne organisation, bon marketing : fidélisons les fidèles.
Samedi 18 août.
Nuit sans sommeil après toute une journée passée à ranger, dans une hâte fébrile. Comme si quelque chose pouvait dépendre de cet empressement ! Voilà, mon travail est fini. J’ai mis de l’ordre partout. Maintenant, il ne reste plus que moi et je redoute le moment du face-à-face devant ce journal. J’ai retourné tout cela dans ma tête, cette nuit. Il faut repartir de sa lettre, seul point de repère. Il m’y confie ses écrits. Mais pourquoi les journaux tout d’abord, et non les quelques textes qui pourraient, moyennant certains remaniements, être proposés à la publication ? Rendre lisibles et déchiffrer mes journaux : la formulation est curieuse. Ne déchiffre-t-on pas généralement l’écriture avant toute correction ? A moins qu’il ne s’agisse de déchiffrement, au sens d’un message codé. Le propos est ambigu. Les dernières phrases de sa lettre annoncent la probabilité d’un événement décisif. Pas de doute, il avait planifié son départ. Je vais lire les cahiers de Frédéric. Ceux qui se donnent la mort lancent une insupportable question à leurs proches. Comment ceux-ci pourraient-ils l’esquiver ? Il faut faire une recherche sur sa disparition. Je lirai les journaux dans l’ordre chronologique. Le premier commence au début de l’année dernière, à l’occasion d’un passage à Saumur, seul, chez ses parents. J’ai trouvé, à côté de ses cahiers, conservés dans des dossiers archives de carton, des lettres et des cassettes de magnétophone. Il me paraît utile de les garder et de les transcrire. Peut-être cet ensemble formera-t-il un récit. A défaut de percer l’énigme, du moins j’aurai accompli ses dernières volontés. Peut-être un jour d’autres que moi s’y intéresseront-ils.
Frédéric
Saumur, vendredi 8 janvier 1994, vingt-trois heures.
Ma chambre d’adolescent, chez mes parents. Un déplacement professionnel m’amène ici, où je ne reste qu’une nuit. Je repartirai demain. A peine changée, cette pièce. On trouve encore dans certains recoins des traces de peinture au pistolet, faites à la construction de ce pavillon, dans les années cinquante. C’est un vilain rose pâle hérissé de petites pointes. Je promenais les doigts sur ces aspérités, me figurant une maquette de reliefs himalayens. Le couchant parfois frappait de feu et d’écarlate le mur du fond. Puis j’ai quitté cette maison pour ne plus y revenir que de loin en loin. Insensiblement, en dépit de tacites promesses, celui que j’étais alors m’est devenu inaccessible : l’adulte a-t-il trahi le jeune homme ? Rien, nul procédé ne peut aujourd’hui me rendre à la violence des émotions de ce temps-là, seul dans cette chambre, devant les crépuscules de juin. Comment dire aujourd’hui cette vague de détresse, lorsque je reviens ici ? Une nostalgie dépressive mêlée à des mouvements d’irritation. La proximité physique de mes parents, qui se réveillent souvent, me dérange. Derrière la mince cloison, j'entends les moindres bruits de gorge, le murmure étouffé des paroles à mi-voix. Lorsque j’habitais ici, j’inventais de petites ruses pour allumer mes cigarettes, feignant un accès de toux pour couvrir le grattement de l’allumette.
Pendant toute la soirée, prisonnier d’un fauteuil profond, j’ai subi l’implacable déroulement de l’après-dîner : la tisane, les questions répétées de ma mère, qui n’écoute pas les réponses, déjà reprise par sa rumination sitôt son dernier mot prononcé. Interrogations empressées, excessive prévenance. Auras-tu assez de deux couvertures ? Faisait-il beau à Paris ? Y avait-il du monde sur la route ? La torpeur me gagne et je finis par me borner à des monosyllabes ou des acquiescements, pour avoir la paix. Une fois servie la tisane, les propos de ma mère se sont focalisés sur les difficultés supposées de mes frères :
C’était un jet continu ! Et la lombalgie de François ! Et les affres de Paul, qui doit déménager de son cabinet ! A-t-il bien fait d’acheter une voiture si luxueuse ? Cela l’oblige maintenant à payer de lourdes traites ! Pour des années ! Et la clientèle médicale de Vincent ? Comment va-t-il s’en sortir ? L'accablement me gagne. C’est malfaisant, insidieux, ainsi qu’un gaz nocif qui se répandrait à mon insu. On ne réalise qu'après-coup l’asphyxie. A quoi riment ces obsédantes ritournelles ? Le tableau de mes frères, ainsi brossé, m’oppresse. Quel est le message caché dans ces paroles ? Peut-être faut-il comprendre que les enfants ne sauront jamais mener leur barque tout seuls. Il leur faudra sans cesse se soumettre aux avis des parents. Dès lors, le but de ce propos deviendrait clair : il s’agirait d’inoculer un état d’insécurité pour maintenir à jamais la progéniture sous la coupe des anciens.
Paris, jeudi 19 janvier 1994
A la sortie de l’université, hier soir, j’ai vu sur le quai du métro une étudiante de mon cours. Je l’avais remarquée, visage joliment dessiné, dont les joues pleines et le menton restent encore poupins. Regard direct, cheveux longs et dorés. Plutôt petite, sa silhouette serait agréable, si elle n’était dissimulée par un épais caban bleu marine et un jean trop large. Avec de gros souliers à bout rond, l’accoutrement est peu seyant et détonne un peu dans cette faculté plutôt chic.
Je me suis surpris à la guetter, mais timidité ou réserve bienséante de la part d’un enseignant, sans m’approcher d’elle. Elle arpente le quai, sans m’avoir repéré et disparaît de ma vue. Alors qu’elle revient, je me poste un peu en retrait, dans un groupe assez dense. Après bien des hésitations, dont triomphe moins mon désir pour elle que l’envie de sortir pour une fois de ma gêne envers les femmes, je me décide, lorsqu’arrive la rame, à la suivre dans le wagon. Curieusement elle s’assied dans le sens inverse de la marche, laissant libre tout le siège qui lui fait face. La densité des voyageurs et le fait qu’elle se mette sur le côté, près de la fenêtre, m’autorisent à m’y installer assez naturellement sans paraître rustre. Elle me voit et me sourit alors spontanément, avec dans les yeux un air de gaieté enfantine. Elle évite cette condescendance polie qu’affectent trop volontiers les jolies filles à Paris pour que tout mâle se sente importun dès qu’il pénètre sur leur territoire.
Je marmonne familièrement, avec une bougonnerie affectée, une banale remarque sur la lenteur des transports en commun. Elle me fait répéter, puis renchérit vivement pour me confier ensuite, presque sans transition, ses soucis avec le cours de comptabilité nationale. Tandis qu’elle parle, son visage s’anime, ses joues se colorent. Elle se tient trop droite sur son siège, cherche une attitude pour se donner de l’assurance. Mal posée, sa voix hésite entre deux registres comme pendant la mue. Maladroite, elle est sur ses gardes, tellement vulnérable. Conversation trop courte pour trouver le véritable fond de la question qui la préoccupe. Il s’agit, selon toute apparence, d’une totale confusion entre la notion de valeur ajoutée et la taxe sur ladite valeur ajoutée. Elle n’a rien compris à la matière. Elle s’appelle Pascale.
Alors que nous descendons à la même station, je suis déçu de voir qu’elle ne prend pas la même correspondance. Je n’esquisse pas un geste d’invitation, sans doute par un réflexe trop ancré de pudeur et de fierté instinctive ; peut-être aussi en raison d’une petite distance qu’elle semblait vouloir mettre entre nous, probablement liée à l’une de mes critiques sur son exposé récent.